Nos recherches
Mobilisations citoyennes & Travail social
Des « mobilisations citoyennes », à l’instar de celles pour l’aide et le soutien aux migrants ou pour le climat viennent, ces dernières années, interroger les pratiques et les valeurs des travailleuses et travailleurs sociaux. Il est reproché aux professionnel·les pour le moins un attentisme et pour le pire une indifférence, voire une complaisance vis-à-vis de politiques qui ignorent ou feignent d’ignorer tantôt les conditions que l’on peut qualifier, à bas mots, de peu humaines dans l’accueil, la prise en charge, l’hébergement, les soins pour certaines franges, particulièrement précarisées, de la population, tantôt la dégradation de l’environnement.
Au sein de ces mobilisations se trouvent également des travailleuses et travailleurs sociaux : certain·es s’y inscrivent « indépendamment » de leur travail professionnel, d’autres indiquent qu’iels font « des ponts », d’autres enfin, envisagent leurs engagements (professionnels, politiques, associatifs) comme un continuum ; iels professionnalisent leur militance.
En dehors de ces mobilisations, certains travailleurs sociaux perçoivent parfois ces mobilisations comme une forme de « concurrence », une mise en cause de leur légitimité et de leur action, alors que d’autres y voient une opportunité et que d’autres encore y sont indifférents.
Objet & objectifs de la recherche
Il s’agit d’explorer ces différentes formes de mobilisations au travers de recherches se centrant sur les rapports entre elles et les professionnel·les : entre « alliance », concurrence, indifférence et parfois instrumentalisation.
Ces recherches pourraient porter sur :
- Les professionnel·les qui s’impliquent dans ces mobilisations : à quel titre, quelles sont leurs propriétés sociales, comment leur implication s’inscrit-elle dans leur trajectoire ?
- Les rapports entre tel ou tel service social et ces mobilisations : entre des services généralistes (CPAS, services d’aide au logement, services de l’AJ, service de santé mentale, etc.), mais aussi avec des services dont l’objet est en relation étroite avec ces mobilisations
- Les pratiques des services sociaux : face à de nouvelles questions, de « nouvelles problématiques », comment les organisations et les travailleuses, travailleurs composent-iels dans leurs pratiques habituelles, avec des modalités législatives qui ne correspondent pas/plus aux situations rencontrées… sous le regard – critique – de ces « mouvements citoyens » ?
- Les formes que prennent aujourd’hui ces mobilisations (formes importées de l’univers du travail social et/ou formes importées d’autres univers) : comment recrutent-elles, forment-elles, s’organisent-elles, font-elles « réseau », etc. ?
- Des comparaisons internationales
Commanditaire : Cérias / Master en ingénierie et action sociales Louvain-la-Neuve | Namur
Étudiant.es du Master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve | Namur impliqué.es dans la recherche :
- Aurélie Basseux : « Le droit d’entrée à Extinction Rebellion : une recherche menée au sein d’Extinction Rebellion Belgique, Bruxelles et Ottawa » (Mémoire soutenu en juin 2020)
- Delphine Saugues : « Les ressorts de l’engagement des individus dans une organisation environnementale (analyse comparée Greenpeace & Extinction Rebellion) » (mémoire soutenu en juin 2020)
- Silvie Philippart de Foy : « Comprendre l’engagement des membres de collectifs de sensibilisation à l’environnement et les raisons de tenir face aux difficultés à susciter l’adhésion d’un public moins convaincu par les causes environnementales » (mémoire soutenu en juin 2022)
- Julie Sterckx : « Devenir militant de sa cause… L’engagement militant de personnes en situation de handicap, travailleurs à l’insertion professionnelle d’autres personnes en situation de handicap » (mémoire soutenu en juin 2022)
- Inès Vanderlinden : « Les conditions de possibilité de l’engagement bénévole auprès de personnes d’origine étrangère et leur influence sur ses modalités » (mémoire soutenu en juin 2022)
- Marie-Céline Peeterbroeck : pratiques militantes de professionnel·les en équipe mobile en santé mentale (mémoire soutenu en juin 23)
- Alexandra Aspeel : usages et effets des pauses chez les travailleuses militantes du secteur à profit social (mémoire soutenu en septembre 2023)
- Gwenaëlle Francis : ressorts des choix des actions collectives investies, analyse de trajectoires militantes (mémoire soutenu en septembre 2023)
- Jacquemin Mathilde : « comment les pratiques de santé communautaire rencontrent les raisons d’être des personnes interrogées ? (mémoire soutenu en juin 2024)
- Céline Schiltz : en cours
Calendrier : 2019 – …
Pair-aidance, Aidant·es proches & Travail social : des complémentarités ?
Depuis plusieurs années, se développent, au sein et à côté des services sociaux, des associations, des dispositifs centrés ou prenant appui sur la pair-aidance et les aidant·es proches. Conjointement, l’appareil législatif, les formations, la reconnaissance (formelle et informelle), les travaux scientifiques et aussi les revendications prennent de l’ampleur. Ils s’inscrivent dans des perspectives plus larges valorisant « l’empowerment », « le pouvoir d’agir », « la capacitation » qui soulignent la place centrale des « usager·ères », des « bénéficiaires » des politiques de santé (autant dans les aspects cure que care) et, plus largement, des politiques sociales. Trop longtemps en effet, iels ont été considéré·es comme les « simples » destinataires de ces politiques sans que soit pris en compte leur avis, leurs savoirs, leurs pratiques, leurs représentations des problématiques qui les concernent.
À l’instar de ce qu’ont montré les recherches portant sur les mobilisations citoyennes (cf. le point I. du présent document), ces associations et dispositifs peuvent apparaitre pour certains professionnel·les du travail social tantôt comme des formes de concurrence de ce qu’ils font et sont et tantôt comme des possibilités de nouvelles contributions dans leurs pratiques. Si « la complémentarité » apparait comme un leitmotiv devant caractériser les relations entre ces professionnel·les et celles-ceux engagé·es dans la proche ou la pair-aidance, elle est encore très souvent difficile – pratiquement compliquée – en raison non seulement des embûches administratives, organisationnelles et légales, mais aussi des représentations et routines sociales et professionnelles.
Objet & objectifs de la recherche
Il s’agit de rendre compte de ce qui existe aujourd’hui ; quelles sont les pratiques, les représentations ; quel·les sont les acteur·rices et les problématiques concerné.es ; quels sont les défis et les enjeux ?
Ces recherches pourraient porter sur :
- Les professionnel·les ;
- celles et ceux dont le travail est de « coordonner » les différent·es acteur·rices de la proche et de la pair-aidance ?
- celles et ceux dont les pratiques sont questionnées, voire remises en question par ces « nouvelles » pratiques, revendications…
- Les formes d’organisation qui peuvent prendre ces pratiques conjointes entre professionnel·les et « personnes concernées » et les types de gouvernance entre ces acteur·rices
- Les pratiques professionnelles face à ces nouvelles questions : comment les travailleuses et les travailleurs composent-iels dans leurs pratiques habituelles avec elles et eux ? Quelles formes et quels contenus prennent leur « complémentarité » ? Génère-t-elle des conflictualités ; lesquelles, comment sont-elles gérées… pacifiées ?
- Qu’en est-il spécifiquement pour telle ou telle problématique ? Quelles sont les problématiques les plus concernées ? Certaines problématiques demeurent-elles « étrangères » à ce mouvement pair-aidance / aidant·es proches ?
- Comment cela se passe-t-il dans d’autres pays avec d’autres contextes économiques, sociaux, culturels ; avec une autre histoire et une autre conception du travail social, une autre représentation des liens familiaux ?
- Faisant suite aux recherches du CÉRIAS, il pourrait également être intéressant de montrer ce que la prédominance du champ médical sur ces problématiques et ces complémentarités a comme impact sur les pratiques, sur leurs représentations et sur les professionnel·les du travail social.
Commanditaire : Cérias / Master en ingénierie et action sociales Louvain-la-Neuve | Namur
Étudiant.es du Master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve | Namur impliqué.es dans la recherche :
- Stéphanie Lemestré : en cours
Calendrier : 2024 – ….
Projet Tandem : accompagnement de la périnatalité en situation de vulnérabilité
Depuis septembre 2019, l’Institut Cardijn (HELHa) et le département Sage-femme de la Haute École Léonard de Vinci, sont réunis dans un partenariat avec l’ASBL Aquarelle (ONE – Hôpital Saint-Pierre à Bruxelles) et ont développé un projet commun : le « Projet d’accompagnement de familles en situation de vulnérabilité en périnatal ». Il est inspiré du projet « Een Buddy bij de wieg » mené depuis plusieurs années à la Haute École Artevelde de Gand.
Le projet s’adresse aux étudiant·es de B3 AS/Sages-femmes. Une dizaine d’étudiantes y participent chaque année.
La population concernée est composée de familles / femmes monoparentales en situation de vulnérabilité et d’exil avant et après la naissance d’un enfant (<1an). Les finalités sont le soutien pendant la grossesse et après la naissance, ainsi que la mobilisation et la construction d’un réseau social autour de la famille / femme. La méthodologie d’intervention est basée sur l’empowerment (capacité d’agir) et la co-intervention socio-médicale en vue d’un accompagnement à domicile, dans la vie quotidienne ; elle inscrit dans la durée. Elle consiste en des visites à domicile et des contacts téléphoniques d’un binôme AS/SF.
Objet & objectifs de la recherche
Il s’agira de poursuivre l’exploration de ce partenariat entre assistantes sociales et sages-femmes ainsi que les modalités et les effets de cette co-intervention, sur différents niveaux.
Les recherches pourraient notamment concerner :
- Le processus de formation à l’œuvre dans ce type de projet et notamment d’examiner comment il intervient dans la professionnalisation (et son évolution) des assistantes sociales et des sages-femmes.
- Le croisement de perspectives sociales et médicales comme articulation du projet.
- Ce qu’apporte ce type de partenariat au travail social et au travail des sages-femmes. Comment permet-il de prendre en compte des éléments non ou peu travaillés par ces deux univers, avec un accompagnement « académique » non contraignant ? La recherche pourrait ainsi être reliée au premier type de recherche présenté dans ce document ; l’engagement dans ce projet pouvant être lié à une forme d’engagement militant.
Commanditaire : Cérias / Master en ingénierie et action sociales Louvain-la-Neuve | Namur
Étudiant.es du Master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve | Namur impliqué.es dans la recherche :
- Gwenaëlle Couteaux : « Quand un engagement et une collaboration professionnalisent l’expérience d’étudiantes assistantes sociales dans une cointervention avec des étudiantes sages-femmes au service de futures mères en situation de précarité et d’exil » (mémoire soutenu en juin 2022)
Calendrier : 2021-2024
Innovations sociales et travail soutenable (Insotra). Collaboration à un projet de recherche du CERSO
La problématique de la recherche consiste à articuler deux défis : les innovations sociales et le travail soutenable
- D’un côté, les innovations sociales sont considérées comme une voie majeure pour relever les défis sociétaux contemporains, tels que le vieillissement de la population, le chômage, la crise du logement, les questions environnementales… dans une optique de développement durable et de modernisation des politiques publiques.
- De l’autre, le monde du travail est de plus en plus exposé à des phénomènes inquiétants, tels que l’augmentation de l’épuisement professionnel, la fragilisation des parcours professionnels et la précarité des conditions d’emploi, dans un contexte de vieillissement de la population active.
Objet & objectifs de la recherche
La question de recherche est la suivante : dans quelle mesure les innovations sociales intègrent-elles une réflexion sur le « travail soutenable » dans leur conceptualisation, leur mise en œuvre et leur organisation ?
Le projet s’appuie sur l’idée que la soutenabilité du travail effectué par les personnes investies dans leur mise en œuvre est une condition incontournable de la pérennisation des innovations sociales.
Dans ce projet, l’objectif sera non seulement de mesurer les éventuelles répercussions de l’engagement dans une innovation sociale sur le parcours professionnel et/ou le parcours de vie des travailleurs, mais également de vérifier dans quelle mesure le travail soutenable est réfléchi et pris en compte dans la mise en œuvre de l’innovation sociale et l’organisation du travail.
Le projet souhaite se centrer sur les innovations sociales en lien avec le travail social et qui articulent 5 caractéristiques :
- Elles questionnent les pratiques de travail social, la posture professionnelle et le rapport à l’usager ;
- Elles visent à répondre aux besoins des publics dits « incasables », dont le profil ne relève d’aucun service existant ;
- Elles reposent sur la collaboration intersectorielle ;
- Elles impliquent d’« aller vers », d’intervenir « dans le milieu de vie des usagers », de se rendre « disponible dans les temps de vie des usagers », et donc préférentiellement « hors les murs » de l’institution ;
- Elles mobilisent les usagers, qu’on les qualifie de bénévoles, d’experts du vécu, de pair-aidants, etc… et les invitent à intervenir, à accompagner, à participer au même titre que les « professionnels ».
La première phase du projet (2021-2022) a permis de réaliser des études de cas d’innovations sociales. Une étudiante de M2 a réalisé dans ce cadre une monographie d’une association.
La recherche a entamé, en 2023 -… une deuxième étape centrée sur l’analyse des trajectoires des travailleuses, des travailleurs à partir de récits de vie. L’objectif est de saisir ce que l’engagement dans la mise en œuvre d’une innovation sociale « fait » au travailleur ou à la travailleuse afin de mettre en lumière les facteurs de fragilisation ou de régénération des parcours professionnels en lien avec cet engagement
Commanditaire : Cérias / Master en ingénierie et action sociales Louvain-la-Neuve | Namur & CERSO
Étudiant.es du Master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve | Namur impliqué.es dans la recherche :
- Laurie Vanbiervliet : « Quelles sont les ressources mobilisées par une association porteuse d’innovation sociale pour intégrer le travail soutenable ? » (mémoire soutenu en juin 2022)
- Régis Grandgagnage : « Dans quelle mesure les services répit, en tant qu’initiative d’innovations sociales, intègrent-ils une réflexion sur le travail soutenable dans leur conceptualisation, leur mise en œuvre et leur organisation ? » (mémoire soutenu en août 2024)
Calendrier : 2021-2022 & 2023-2024
Genre & Travail social (métiers et formations)
On le sait, les métiers et formations du travail social sont très majoritairement féminins, mais les hommes y occupent, proportionnellement plus que les femmes, des positions dominantes (Bessin 2013 ; Cardoso, 2020, Gaspar, 2012 ; Molina, 2018). Si ce constat est très largement connu et reconnu, il demeure encore très souvent tu, invisibilisé et ne suscitant bien souvent que des dénonciations qui peinent à se traduire dans un changement des pratiques.
Qu’en est-il dès lors précisément dans les pratiques quotidiennes sur les différents terrains du travail social, qu’en est-il aussi des pratiques de recrutement et de « gestion des ressources humaines » dans les institutions et services sociaux, qu’en est-il précisément dans les cours et la vie – étudiante et professionnelle – des instituts de formation en travail social, qu’en est-il dans les « priorités » des organisations – nationales et internationales – professionnelles promouvant le travail social ?
Objet & objectifs
Il s’agit ici
- soit de faire précisément de la division genrée du travail social et des processus d’invisibilisation de la prise en charge majoritairement féminine des problématiques relevant du « traitement social de la question sociale » (Chauvière) ?
- soit de voir comment et par qui cette problématique est prise en compte, mise à l’agenda au sein des fédérations, des secteurs, des institutions, des services, des instituts de formation, des associations représentatives ?
- soit de mettre en lumière tel ou tel élément de cette vaste thématique : les freins à l’ascension professionnelle, la force de l’incorporation des stéréotypes de genre, les luttes féministes contre les formes d’enfermement dans des rôles sociaux traditionnels, les composantes de la « violence symbolique » (Bourdieu) inhérente à la division genrée du travail (donc aussi du travail social), la place de cette thématique dans les cursus des instituts de formation au travail social, etc.
- soit spécifiquement, à la suite de mémoires déjà réalisés dans le MIAS LLN|Namur, de mettre en évidence les freins politiques et sociaux rencontrés par les femmes (dans l’accès) à des postes à responsabilités
Commanditaire : Cérias / Master en ingénierie et action sociales Louvain-la-Neuve | Namur
Étudiant.es du Master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve | Namur impliqué.es dans la recherche :
- Maxime Procès : « Les représentations de la masculinité chez les professionnel·les de l’accueil des demandeurs et demandeuses de protection internationale » (mémoire soutenu en septembre 2023)
Calendrier : 2022-2024
Évolution du métier d’éducateur au Service de Logements Supervisés « Mon projet » / Ciney
L’équipe des professionnels du Service de Logements Supervisés « Mon projet » (SLS) est confrontée à une double évolution :
- de la « nature » de ses activités : passage de l’hébergement à l’accompagnement
- des types de public pris en charge
À l’automne 2023, seront fêtés les 20 ans du SLS. La préparation de cet anniversaire est une opportunité pour mettre en réflexion les impacts sur les professionnel.les – particulièrement les éducateurs.rices – de ces évolutions.
Ces constats ne sont pas des isolés. De nombreux services vivent / ont vécu ce type d’évolution.
La littérature scientifique a montré et continue de montrer ce que celles-ci doivent aux pressions politiques et gestionnaires qui pèsent sur le travail social et les professionnel.les (aussi bien les travailleur.euses, que les cadres, que les directions) : quantification, activation, démarche qualité, judiciarisation, exacerbation des contrôles, etc. Les professionnel·les doivent ainsi « naviguer » entre des demandes souvent difficilement compatibles : celles des usager·ères (et de leurs proches), des pouvoirs subsidiants (parfois multiples), des acteurs et actrices politiques, des services, des organisations, etc.
Il s’agira précisément ensemble de décrire et de comprendre ces évolutions au cœur des (de certaines) pratiques du SLS.
Objet & objectifs
Ce type de recherche qui se situe dans la mouvance et l’héritage de la « Recherche-action » est assez peu formalisé. Si cette absence relative de formalisation peut s’avérer une richesse dès qu’il s’agit d’associer des actrices et acteurs soucieux de mettre au travail leur expérience et leurs savoirs (théoriques et expérientiels), cela peut également s’avérer une source de faiblesses ; la principale étant, par manque de rigueur, de prendre la recherche comme « prétexte » pour reproduire, voire amplifier, des discours dominants, des croyances voire des préjugés, des stéréotypes qui rigidifient les possibilités de compréhension et d’actions. Il est donc intéressant – et essentiel – qu’un.e chercheur.euse puissent « accompagner » le processus et interviennent à la fois pour interroger et garantir ce processus et les savoirs mis en évidence.
Les finalités seront
- de décrire ces évolutions au sein du SLS
- de dégager des éléments de compréhension
- d’esquisser des pistes d’action praticables face aux multiples contraintes, mais aussi aux opportunités, que rencontrent les éducateurs dans leurs pratiques quotidiennes : de la résistance à la proposition d’alternatives .
Les objectifs intermédiaires articulés autour du processus de recherche collaborative seront:
- de prendre en compte de l’histoire du service : « d’où venons-nous ? »
- de faire un état des pratiques actuelles des éducateurs
- de relater leur évolution dans les dernières années ?
- d’identifier les invariants et les variants dans les pratiques des éducateur.rices ?
- de mettre en évidence les perspectives, entre inquiétudes et attentes de la direction, des cadres, des travailleur.euses
Commanditaire : Service de Logements Supervisés « Mon projet » / Ciney
Chercheuse : Claire Bernis
Calendrier : 2022-2024
Leçons de la pandémie
Ce projet de recherche résulte d’une collaboration avec le CÉRIAS consultance.
Passé le moment de sidération, les organisations de l’univers du travail social et plus largement du secteur à profit social ont réagi aux multiples contraintes hygiénistes/médicales et très vite légales qui leur ont été imposées à la suite du développement de la Covid 19. Les premiers retours d’expériences et les premières recherches mettent en avant une grande adaptabilité et une grande flexibilité des organisations, même si cela cache parfois des réalités bien différentes et, surtout, bien inégales. L’ordre des priorités s’est bien souvent effacé devant les « impératifs médicaux ». Les travailleurs, les cadres et les usagers ont été sommés de travailler, manager, vivre autrement – « à distance » – remettant en cause, parfois de manière très profonde, ce qui leur paraissait être au cœur de leurs activités. Parfois aussi les modes d’organisation, adoptés pendant les premiers mois de la crise, ont ouvert de nouvelles perspectives.
Il est attendu de cette recherche qu’elle fournisse des éléments de compréhension de ce qui s’est passé et se passe encore en considérant cette pandémie comme un « analyseur » ; un révélateur, voire un exacerbateur (peut-être aussi un inhibiteur ?) de logiques sociales déjà là ou émergentes ( ?).
Objet & objectifs
Il s’agirait ici
- soit de faire état de ces multiples expériences, de rendre compte de la manière dont les organisations, les travailleurs, les cadres, les usagers ont « vécu » (subi, résisté, innové…) les premières étapes de cette pandémie.
Une attention particulière pourrait être portée sur les cadres. En effet, les premières enquêtes montrent qu’ils ont joué un rôle central dans la gestion de la pandémie au sein des organisations et dans le soutien aux travailleurs. - soit de montrer comment certaines organisations, certains travailleurs, certains cadres, certains publics ont transgressé les injonctions médicales, légales résultant de cette pandémie. Ces « transgressions raisonnées » peuvent être interprétées en première analyse tantôt comme des mécanismes d’adaptation (il s’agirait alors d’analyser « la pratique en train de se faire »), tantôt comme la poursuite, sur un « nouveau » terrain, de luttes de concurrence entre « groupes professionnels », entre « logiques ».
- soit de montrer quel est l’impact, aujourd’hui en 2022, de cette pandémie sur la fragilité des équipes et les difficultés que rencontrent de nombreux services pour recruter
Commanditaire : Cérias / Master en ingénierie et action sociales Louvain-la-Neuve | Namur
Étudiant.es du Master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve | Namur impliqué.es dans la recherche :
- Thomas Magny & Marine Toussaint : « Comment les mesures induites par la crise sanitaire s’inscrivent-elles dans les enjeux d’une organisation en pleine redéfinition ? Recherche dans une institution à la frontière entre Aide à la jeunesse et milieu carcéral » (mémoire soutenu en juin 2022)
Calendrier : 2021-2022
Les professionnels du travail social & le champ médical
Impact du champ médical sur l’univers du travail social
Objet : La recherche commanditée par Hospisoc (juin 2016 – mars 2018) a mis en lumière le rapport subjectif des travailleurs sociaux à leurs pratiques au sein des hôpitaux et les conditions dans lesquelles s’opèrent leurs pratiques. Il s’agit ici d’approfondir les résultats de cette recherche par des recherches centrées sur cette forme particulière de professionnalisation dans ou en contact avec les hôpitaux (considérés comme « structures structurantes »).
Ces recherches pourraient porter
- sur les travailleurs sociaux soit au sein des hôpitaux, soit engagés par des hôpitaux, mais travaillant hors des hôpitaux, soit qui ne travaillent pas au sein des hôpitaux, mais qui sont en contact fréquent avec les hôpitaux et, plus largement, avec le champ médical.
- sur les formes organisationnelles : que font ces modes d’organisation spécifiques aux professionnels ?
- sur la sociogenèse de ce type de pratiques professionnelles : quels sont les impacts et les traductions effectives sur la professionnalisation des services sociaux des disciplines dominantes dans le milieu hospitalier et des modes de gestion liés à la NGP ?
- …
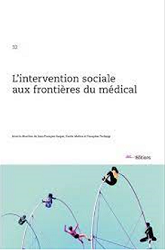
Commanditaire : Master en ingénierie et action sociales Louvain-la-Neuve | Namur
Direction de la recherche : Jean-François Gaspar
Étudiant.e.s du Master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve | Namur impliqué.e.s dans la recherche :
- Amélie Applincourt : « Professions sociales et médicales : travailler ensemble ? Analyse croisée entre Bruxelles et Genève (les relations entre les services d’aide à la jeunesse et la pédopsychiatrie) » (mémoire soutenu en juin 2019)
- Claire Bernis : « Assistants sociaux et médecins du bas seuil : deux professions en concurrence ? » (mémoire soutenu en janvier 2020)
- Laetitia Honoré : « Comment les infirmières des services de promotion de la santé font-elles profession dans l’espace de la médecine scolaire » (mémoire soutenu en janvier 2020)
- Alexandra Al Haffar : « L’intégration du sentiment d’incompétence des travailleurs sociaux de première ligne dans leurs rencontres professionnelles avec des usagers de drogues » (mémoire soutenu en juin 2020)
- Jean-Philippe Mathy : « La coordination au sein des maisons médicales. La professionnalisation comme enjeu individuel et collectif » (mémoire soutenu en juin 2020)
- Magaly Nees : « La reconnaissance et la « place » des éducateurs : quelles stratégies déployées pour ces professionnels en service résidentiel pour des adultes en situation de handicap moteur avec troubles associés ? » (Mémoire soutenu en juin 2021)
- Bérengère Juvent : « Comment les assistantes sociales s’ajustent-elles dans la durée, dans un milieu psychiatrique ? » (mémoire soutenu en juin 2021)
Calendrier : Septembre 2018 / Janvier 2021
Prévention primaire du burn-out
Projet concernant le soutien à la prévention primaire du burn-out dans les organisations du non-marchand
Objet : L’objectif est d’identifier les outils et les bonnes pratiques visant à prévenir le burn-out des équipes dans le secteur non marchand.
Ce projet se décline en trois temps :
- Des accompagnements d’équipe dans le secteur non marchand, concernant des thématiques liées à la prévention primaire du burn-out.
- Des groupes de travail inter-institutions (composés de représentants des associations bénéficiant d’un accompagnement) permettant d’échanger sur les bonnes pratiques relatives à la prévention primaire du burn-out.
- Un rapport de recherche synthétisant les échanges et proposant des pistes d’outils et de bonnes pratiques sur cette thématique.
En 2019, ce projet a permis d’accompagner 20 organisations du non-marchand. Les GT inter-institutionnels ont dégagé des constats concernant les risques liés au burnout dans ces organisations, et ont relevé plusieurs pistes d’action et de réflexion.
Le projet a été renouvelé en 2020, 2021, 2022 à destination de nouvelles organisations du non-marchand. L’objectif était de préciser les constats de 2019 et d’approfondir des pistes de travail spécifiques autour de quatre questions :
- Comment assurer la prévention primaire du burn-out en lien avec les difficultés rencontrées dans la relation aux bénéficiaires ?
- Comment l’équipe peut-elle être une ressource pour la prévention primaire du burn-out ?
- Quelles sont les conditions d’un management participatif permettant la prévention primaire du burn-out ?
- Quels sont les outils GRH qui permettent de structurer les relations de travail, et favorisent la prévention primaire du burn-out ?
Commanditaire : APEF
Equipes de recherches : CÉRIAS &CERSO
Chercheuses : Harmony Glinne (2018-2020), Mélanie Latiers (2020-2021), Claire Bernis (2021-2022)
Calendrier : 2018 – 2022
Services Agréés Partiellement Subventionnés : les discriminations rencontrées par les usagers
Etude exploratoire concernant les discriminations rencontrées par les usagers des SAPS
Objet : L’objectif est de clarifier l’impact des inégalités de financement entre SAPS et services totalement subsidiés sur la vie quotidienne des bénéficiaires, en identifiant à la fois les modalités de fonctionnement spécifiques aux SAPS (manque de place, facturation des services aux résidents, turn-over du personnel…) et l’impact de ces modes de fonctionnement sur les usagers (quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien ?). Au travers de cette étude, un état des lieux de la situation actuelle des SAPS sera établi afin de rendre visibles les effets de ces discriminations non seulement aux yeux des responsables politiques, mais aussi, plus globalement, aux yeux de l’opinion publique.
Commanditaire : Collectif SAPS
Direction de la recherche : Harmony Glinne
Calendrier : Octobre 2018-Mars 2019
Fonds Isajh : « Groupes à risque »
Un secteur en évolution : quelles nouvelles initiatives pour les groupes à risque ?
Objet : La problématique des travailleurs faisant partie des groupes à risque est au cœur des travaux de recherche des trois centres de recherche. Nos complémentarités et notre connaissance des secteurs concernés (handicap, jeunesse, maison d’accueil) ainsi que nos expériences antérieures pour d’autres projets du Fonds Isajh sont un atout considérable.La volonté de co-construction avec le Comité de gestion et le Comité pilotage du Fonds Isajh de l’objet à étudier, des priorités de la recherche, du processus et des modalités d’action à envisager est centrale dans cette recherche. Trois phases rythment ce projet. La phase exploratoire permet d’objectiver les différents points de vue présentés dans l’appel d’offre. La phase de recherche développe sept études de cas, sur base de la radiographie réalisée dans la phase précédente. Le rapport final sera principalement centré sur : les mutations que nous avons pu observer dans les secteurs concernés, les modalités existantes de support des groupes et fonctions à risque et les actions à envisager. De plus une collaboration, en France, avec le Laboratoire Printemps (Professions, Institutions, Temporalités) de l’Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines et, en Suisse romande, avec le LaReSS (Laboratoire de Recherche Santé-Social) de la Haute École de travail social et de santé de Lausanne (HES-SO) permet de comparer ce qui se passe dans ces pays proches et de prendre en compte les actions qu’ils développent. Enfin, nous développons avec les travailleurs faisant partie des groupes à risque, une méthodologie particulière et innovante centrée sur une démarche photographie accompagnée par une attention particulière aux parcours individuels.
Commanditaire : Fonds Isajh
Équipes de recherche : partenariat entre le CÉRIAS, le CERSO et CASPER (Université Saint-Louis / Bruxelles) avec la participation du Laboratoire Printemps (France), du LaReSS (Suisse) et pour la démarche photographique de Frédérique Bribosia et Dominique Simon.
Direction de la recherche : Véronique Degraef (CASPER), Jean-François Gaspar (CÉRIAS), David Laloy (CERSO)
Chercheurs : Naoual Boumedian, Véronique Degraef, Harmony Glinne, David Laloy, Emmanuelle Lenel et la participation d’Emeline Legrain, étudiante du MIAS Louvain-la-Neuve | Namur (2016-2017)
Rapport de recherche : : https://cerso.helha.be/wp-content/uploads/2019/01/ISAJH-Rapport-final.pdf
Calendrier : Février 2016 / Février 2018
Association Francophone des Travailleurs Sociaux Hospitaliers / Hospisoc
« Recherche sur les spécificités du travail social dans les services sociaux hospitaliers & sur les modalités de développement de l’AFTSH (Association Francophone des Travailleurs Sociaux Hospitaliers »
Objet : mettre en évidence
- Les spécificités du travail social dans les services sociaux hospitaliers : cette recherche s’attèlera à clarifier et préciser à la fois les enjeux et les pratiques communes du travail social en milieu hospitalier. De surcroît, il conviendra de mettre en lumière et de prendre en compte les mutations profondes qui affectent le travail social et plus particulièrement celles qui concernent les pratiques sociales en milieu hospitalier ; elles ont en effet des impacts sur l’organisation du travail, des services et remettent souvent en question le sens que les travailleurs sociaux donnent à leur engagement. Dans certains cas, elles remettent en cause l’existence même de certains services.
- Les stratégies à développer en tant qu’association représentative des travailleurs sociaux en milieu hospitalier
Commanditaire : AFTSH devenue HOSPISOC
Équipe de recherche : CÉRIAS (CÉRIAS Recherche et CÉRIAS Consultance)
Direction de la recherche : Jean-François Gaspar & Harmony Glinne
Chercheuses : Naoual Boumedian, Harmony Glinne
Assistante de recherche : Caroline Debaille
Calendrier : Juin 2016 / Mars 2018
Fonds Old Timer / Tutorats fin de carrière
« Production de données concernant les projets tutorat fin de carrière soutenus par le Fonds Old Timer dans le cadre du Plan Tandem dans les secteurs de la SCP 319.02 »
Objet : Quelles sont les pratiques de tutorat observées dans les institutions bénéficiant du soutien du Fonds Old Timer ?
Quel est l’apport du tutorat à différents niveaux : le tuteur, le tutoré, la personne sur le départ, l’équipe, l’institution, la pratique…
Quelles sont les conditions (organisationnelles, matérielles, pédagogiques) qui permettent un déploiement et un apport optimaux du tutorat ?
Cette évaluation nécessite, dans un premier temps, de produire des données afin d’avoir des premières tendances et pistes de réponse à ces trois questions. C’est à cet objectif qu’est consacrée cette recherche.
Commanditaire : Fonds Old Timer
Équipes de recherche : Partenariat CERSO et CÉRIAS
Direction de la recherche : David Laloy
Chercheuses : Florence Kayaert, David Laloy, Maris Schot
Chercheur en appui : Jean-François Gaspar
Calendrier : Septembre 2016 / Décembre 2016
Les travailleurs sociaux dans les maisons de peine
Les travailleurs sociaux dans les Maisons de peine. Quel est l’impact du cadre sur les travailleurs ?
Objet : Travaillant au sein de lieux clos, devant répondre à des injonctions politiques, sociales, médiatiques, gestionnaires difficilement compatibles, voire contradictoires, comment les assistantes sociales travaillant dans les Maisons de peine en Belgique parviennent-elles à trouver des raisons qui leur permettent d’accomplir leur mission ? Quels sont les arrangements qu’elles trouvent pratiquement travailler au sein de multiples tensions ?
Commanditaire : Master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve | Namur
Chercheurs : Jean-François Gaspar et Son Tran
Calendrier : Septembre 2015 / Décembre 2016
Plan Local d’Intégration du Centre Régional d’Intégration de Charleroi
Soutien à la mise en place du Plan Local d’Intégration (PLI) de Charleroi par le Centre Régional d’Intégration de Charleroi
Objet : le nouveau décret wallon relatif à l’intégration des personnes étrangères institue la mise en place d’un Parcours d’accueil pour les primo arrivants comme mission supplémentaire pour les CRI. Le Plan Local d’Intégration (PLI) prend une importance capitale dans ce dispositif socio-politique local.
Le CERSO, spécialisé dans l’accompagnement méthodologique, et le CÉRIAS, spécialisé dans la recherche scientifique réunissent les multiples facettes que nécessite le soutien à une équipe réalisant un Plan Local d’Intégration.
Le CERSO sera prioritairement chargé de l’accompagnement méthodologique et le CERIAS sera un soutien scientifique pour les aspects liés aux éléments de recherche.
La complémentarité des deux équipes permettra de rencontrer les différents aspects qui seront abordés par le Centre Régional de Charleroi dans la réalisation du PLI.
Commanditaire : Centre Régional de Charleroi
Équipes de recherche : partenariat entre le CÉRIAS et le CERSO (offres sur mesure)
Direction de la recherche : Jean-François Gaspar et Nathalie Thirion
Chercheuse : Josiane Fransen
Calendrier : Septembre 2015 / Septembre 2017
Fonds ISAJH / Tutorat
Recherche action concernant le tutorat dans le secteur de SCP 319.02 (les principaux secteurs sont la prise en charge des personnes en situation de handicap, l’Aide à la jeunesse et l’aide aux adultes en difficulté)
Objet : L’enjeu est de « définir les initiatives utiles à prendre par le Fonds Isajh concernant le soutien au tutorat et favoriser, de ce fait, la prise de décision en ce qui concerne les actions à mettre en place. » Le Fonds a déjà tenté de mettre en place un dispositif de tutorat (CCT du 6 mai 2003), mais sans succès. Un très rapide tour de la littérature montre que la pratique du tutorat est très largement répandue même si elle n’est pas nommée en tant que telle. Cependant les pratiques sont peu formalisées. Si elles sont qualifiées d’intéressantes, elles n’en sont pas moins « lourdes » et si elles concernent des travailleurs âgés, elles ne sont pas une modalité de « fin de carrière ».
Il s’agira dans la première phase de la recherche de faire une revue de la littérature et de dresser un inventaire des pratiques. Prenant appui sur la première phase, la deuxième phase aura pour objectif d’expérimenter des pratiques de tutorat. La dernière phase, articulée à la deuxième, évaluera ces expérimentations et aboutira sur des recommandations pour ce secteur.
Commanditaire : Fonds social ISAJH
Équipe de recherche : partenariat entre le CÉRIAS et le CERSO
Direction de la recherche : Naoual Boumedian et David Laloy
Chercheurs en appui : Jean-François Gaspar et Paul Lodewick
Calendrier : Novembre 2013 / Décembre 2015
Fonds Social pour les Hôpitaux Privés / Tutorat
Étude exploratoire des pratiques de tutorat dans les institutions hospitalières francophones
Objet : Il s’agira dans cette étude exploratoire d’identifier premièrement : les premiers éléments d’une cartographie de la fonction Tutorat : recensement (non exhaustif) des études menées dans le secteur non-marchand, premier relevé du lexique et de la terminologie (tuteur, référent, parrain…), recensement (non exhaustif) de pratiques actuelles, dans le secteur des hôpitaux privés, dans le non-marchand, premier essai d’une typologisation des formes de tutorat, identification des enjeux majeurs pour le secteur, recensement (non exhaustif) des outils mis à disposition des tuteurs, des institutions (dans et en dehors de la formation). Deuxièmement, des formes de soutien possibles à cette fonction au sein de l’hôpital : formations spécifiques, E-learning, échange de bonnes pratiques, etc. Troisièmement, des pistes à développer pour faire une étude approfondie
Commanditaire : Fonds social pour les hôpitaux privés
Direction de la recherche : Naoual Boumedian
Calendrier : Mars 2014 / Mi-Décembre 2014
AMO / DSL
Accompagnement méthodologique et épistémologique du Diagnostic social local réalisé par l’AMO Oxyjeune (Sivry-Rance) et par l’AMO Ciac (Couvin)
Objet : Pour le printemps 2014, les AMO doivent réaliser un « diagnostic social local ». À l’initiative du Cabinet de la Ministre de l’Aide à la Jeunesse, Évelyne Huytebroeck, le Centre d’Études Sociologiques de l’Université Saint-Louis à Bruxelles et l’ASBL « Le Grain » ont rédigé un « guide » pour la réalisation de ces diagnostics. Si ce guide constitue un outil utile, la mise en œuvre des moyens proposés requiert une maitrise de diverses méthodologies de recherche, ainsi qu’un bagage épistémologique conséquent. De plus, comme pour toute recherche ou étude, il est essentiel que le chargé de recherche, travaillant dans l’AMO, chargé de réaliser ce diagnostic – puisse prendre appui sur un espace dans lequel il pourra non seulement élaborer le processus de recherche, mais aussi où il développera un regard réflexif sur le processus à l’œuvre, sur son implication, sur les éventuels biais auxquels serait soumise la recherche, etc. Bref, où il pourra opérer « la rupture épistémologique » indispensable à toute recherche.
Commanditaire : Fondation Wartoise
Direction de la recherche : Jean-François Gaspar
Calendrier : Juin 2013 / Mars 2014
DSL : innovation & transformation sociale ?
Impacts de la démarche liée au DSL sur « l’importance sociale » des travailleurs des AMO
Objet : Les intentions politiques de la démarche liée à la réalisation des deuxièmes diagnostics sociaux locaux dans les services AMO sont claires : il s’agit, dans un processus participatif, de soutenir et d’« outiller » les AMO pour produire ces diagnostics. Comment ce processus (v)a-t-il influé(er) sur le « sentiment de compter pour les autres », sur l’« importance sociale », bref, sur « l’économie des biens symboliques » (Bourdieu, 1997) de ces travailleurs sociaux ? La volonté politique, exprimée initialement, a-t-elle permis que cette innovation sociale donne lieu à une transformation sociale visant à la prise en compte politique du travail réflexif des travailleurs sociaux ?
Commanditaire : Master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve | Namur
Direction de la recherche : Jean-François Gaspar
Calendrier : Juin 2013 / Avril 2014
Cellule d’accompagnement / Verviers
Étude du fonctionnement de la Cellule d’accompagnement social de Verviers
Objet : Il s’agira dans cette recherche de rendre compte du fonctionnement de la Cellule d’accompagnement social hébergée par le Comité subrégional de l’emploi et de la formation de Verviers. Prise en charge et animée depuis sa création depuis 2007 par des bénévoles, on examinera, au départ des pratiques concrètes actuelles, les conditions de pérennisation et de professionnalisation de cette Cellule.
Si la Cellule joue un rôle social essentiel dans l’accompagnement des personnes endettées dans la région de Verviers, il importe aujourd’hui de mettre en évidence les pratiques (aussi bien matérielles que discursives) qui permettent d’une part, à ces personnes au-delà de leur situation problématique, de maintenir un degré suffisant d’affiliation sociale (R. Castel, 1995, 2001, 2005) et d’autre part, aux bénévoles de faire connaitre et reconnaitre le champ et la portée de leurs activités (B. Harvard Duclos & S. Nicourt, 2000), notamment – mais pas exclusivement – au sein du monde judiciaire (H. Michel & L. Willemez, 2009). Concernant ces pratiques, il s’agit ainsi non seulement de les valider, de les légitimiser, mais aussi de les institutionnaliser et de leur assurer un support qui pourrait assurer, voire accroitre, leur pertinence sociale.
Commanditaire : Comité subrégional de l’emploi et de la formation (Forem) à Verviers
Direction de la recherche : Jean-François Gaspar
Chercheuse : Naoual Boumedian
Calendrier : Septembre 2013 / Janvier 2014
AMO / Arrondissement judiciaire de Namur
Recherche-action pour la Plateforme des AMO de l’arrondissement judiciaire de Namur : Bien-être à l’école. Projet « accrochage scolaire » (avec le soutien du Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse de Namur)
Objet : Les initiateurs de ce projet soulignent que l’école peut être un lieu de « bien-être » pour les jeunes. Souvent stigmatisée, socio-historiquement non sans raison, pour son rôle charnière dans les processus de relégation, l’institution scolaire tente aujourd’hui de se défaire de ce grief. Les établissements scolaires essayent non seulement de mettre à profit le temps passé par les jeunes en leur sein, mais aussi constituent un des espaces, essentiels, de reconnaissance, d’apprentissage et de citoyenneté pour ceux qui, nombreux, ne peuvent bénéficier d’autres lieux de valorisation de ce qu’ils sont, font, connaissent et découvrent. Le bien-être des élèves apparaît comme une des conditions essentielles d’accrochage à l’école. Celui des enseignants et des intermédiaires parascolaires représentent une condition primordiale de possibilité de projets communs.
Commanditaire : Plateforme des AMO de l’arrondissement judiciaire de Namur
Direction de la recherche : Jean-François Gaspar
Chercheuse : Naoual Boumedian
Calendrier : Mars 2012 / Juin 2013
Accompagnement / Rouen
L’Accompagnement Institutionnel pour le Développement Economique et Social : formes, structuration, enjeux et limites (volet belge d’une recherche pilotée par le département de sociologie de l’Université de Rouen).
Objet : La globalisation de l’économie, le désengagement progressif de l’État, la concurrence généralisée dans les secteurs privés et publics, le relatif échec des politiques publiques en matière d’emploi, de justice sociale induisent une recherche de nouvelles solutions à moindre coût. Une harmonisation internationale des politiques publiques dans le cadre d’un capitalisme mondial repose sur l’incitation à la responsabilisation et l’autonomisation individuelle (Palier, Prevost, 2006) qui trouve sa pleine expression au niveau local. À cette échelle, de nombreux dispositifs publics, visant par exemple l’insertion ou la réinsertion sociale et/ou économique des individus en difficulté, intègrent des procédures d’accompagnement proposées comme une possibilité d’aide ou de soutien (logistique, psychologique, méthodologique). Cependant, ce qui est présenté souvent au départ comme une contribution positive et facultative mue souvent en une option imposée comme une nécessité voire un impératif.
Commanditaire : Master en ingénierie et action sociales Louvain-la-Neuve | Namur (avec soutien du département de sociologie de l’Université de Rouen)
Pilotage de la recherche : Jean-Louis Le Goff (Université de Rouen)
Direction du volet belge de la recherche : Jean-François Gaspar
Chercheuses / Chercheurs : Jean-François Gaspar & Étudiants du M2 (2010-2011 & 2011-2012)
Calendrier : Mars 2010 – Juin 2012